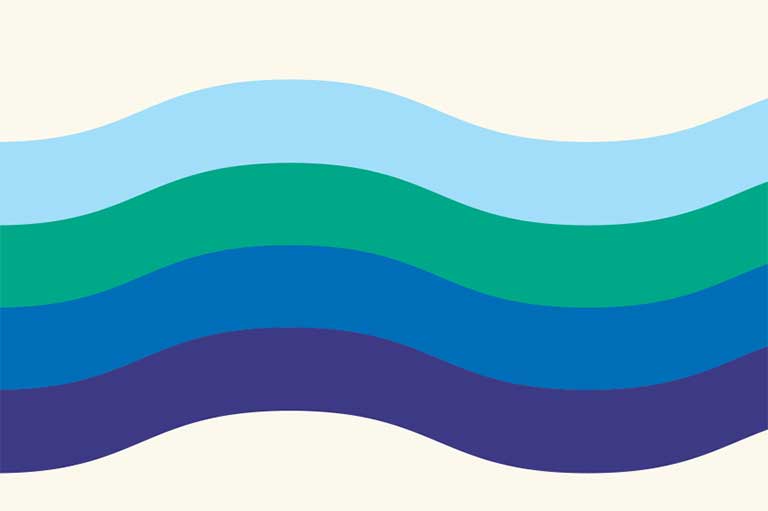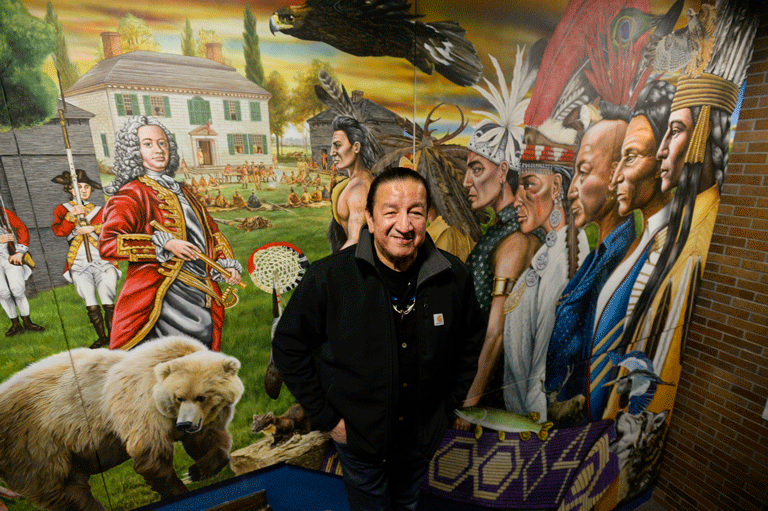Interpréter les Traités

En 1993, Donald Marshall Jr, un Micmac de l’Île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, vend 201 kilogrammes d’anguille à une entreprise du Nouveau-Brunswick. Le gouvernement fédéral accuse alors Marshall de vendre du poisson sans permis. Ce dernier invoque un Traité de 1760 que ses ancêtres ont signé avec les Britanniques et qui lui donne le droit de vendre du poisson. Le fait de l’obliger à se procurer un permis commercial constitue, selon lui, un fardeau déraisonnable contrevenant à ses droits (constitutionnels) issus de ce Traité. Après une bataille juridique de six ans, la Cour suprême du Canada lui donne raison, tout en affirmant que ces droits pourraient se limiter à des fins de conservation et d’autres motifs.
L’affaire Marshall montre bien comment les Premières Nations, les historiens, les avocats et les juges interprètent les Traités différemment.
En effet, les Traités ont été rédigés en anglais et contenaient des phrases difficiles à traduire dans les langues des Premières Nations. Le terme « légalement », par exemple, apparaît dans un Traité de 1725. Comment ce terme a-t-il été compris? Les représentants britanniques l’ont-ils compris différemment de leurs interlocuteurs autochtones?
Les historiens qui se penchent sur cette question décrivent souvent le contexte historique dans lequel une phrase a été écrite pour tenter de comprendre l’interprétation qu’en faisait chaque partie. Il faut cependant reconnaître que le terme « légalement » est ambigu. De quelle loi est-il question? La loi britannique? La loi autochtone? Ou un mélange des deux? Les lois britanniques ne régissaient-elles que les lieux où les Européens s’étaient installés? Est-ce que les lois autochtones continueraient d’encadrer tous les échanges hors des colonies? Même si nous ne pouvons pas répondre clairement à toutes ces questions, le fait même de les poser nous permet de tracer les contours de la pensée autochtone de l’époque.
Nous en savons davantage sur la façon dont les Européens du 18e siècle interprétaient ces questions, car leurs écrits à ce sujet ont été préservés. Nous sommes donc mieux en mesure de comprendre comment ils interprétaient le terme « légalement », puisque nous pouvons reconstruire la société dans laquelle ce terme a été employé.
Nous en savons cependant moins sur les peuples autochtones d’avant 1763, puisqu’ils ne conservaient pas de documents historiques, contrairement aux Européens. Par contre, nous savons que les Premières Nations gardent la mémoire de ces Traités, et que cette mémoire est transmise aux générations suivantes.
Cette approche est évidente dans la région de l’Atlantique, où les Premières Nations faisaient référence à des Traités signés antérieurement. Par exemple, en 1749, lorsque le gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Edward Cornwallis, demanda aux Malécites s’ils se souvenaient d’un ancien Traité qu’ils avaient signé, son interlocuteur lui répondit qu’il en avait une copie et « qu’il était venu pour renouveler le Traité ». Un siècle plus tard, dans une requête à la Reine Victoria, les Chefs micmacs affirment « qu’ils ne peuvent ni oublier, ni douter de ce que leur ont dit leurs pères au moment où la paix a été signée ». Dans un tribunal de Port Hood, à l’Île du Cap-Breton, en juillet 1928, Joe Christmas, alors âgé de 72 ans, rapporte que selon ce qu’il retient du Traité, « nous avons le droit de chasser et de pêcher en tout temps. Je ne sais pas lire. Je l’ai entendu de la bouche de mes grands-pères. Ils m’ont dit que le Roi d’Angleterre avait conclu un Traité avec les Micmacs. Avec toute la tribu. »
Comme d’autres Premières Nations dans l’Est de l’Amérique du Nord, les peuples de la région de l’Atlantique immortalisaient leurs souvenirs sur des ceintures wampum. Ces ceintures étaient composées de milliers de coquillages assemblés de façon à représenter divers symboles. Elles servaient lors des échanges diplomatiques avec les représentants européens et avec d’autres peuples des Premières Nations. Ces ceintures sont ensuite devenues des outils mnémoniques servant à rappeler les dispositions d’anciennes ententes.
Ces exemples montrent que les Premières Nations conservaient des « copies » des Traités, transmettaient leur histoire orale aux générations suivantes et immortalisaient cette mémoire collective sur des ceintures wampum. Cependant, plus cette mémoire est lointaine, plus il devient difficile de comprendre ce qu’elle représente réellement. C’est ce qui rend l’interprétation des Traités si difficile.
Mais également, la colonisation européenne a profondément divisé les communautés des Premières Nations : il est donc devenu particulièrement difficile de définir ce que ces peuples comprenaient des Traités au moment de leur signature.
Comme les sociétés autochtones ont connu d’importantes transformations après 1600, les historiens ont de la difficulté à reconstruire leurs histoires. Par exemple, au début du 19e siècle, les Béothuks de Terre-Neuve et Labrador avaient cessé d’exister en tant que peuple distinct. Ils conservaient quelques rares relations commerciales avec des pêcheurs européens, selon les saisons, mais la perturbation de leurs territoires de chasse et de pêche par les colons européens a entraîné leur brusque déclin. Souvent dénutris, ils devinrent vulnérables aux maladies transportées par les Européens. Les conflits tendus entre les colons et les Béothuks laissèrent également de profondes séquelles.

Tsaminik Rankin, un Chef spirituel algonquin de la réserve de Pikokan, en Abitibi, au Québec, purifie les quatre directions à l’aide d’un calumet de la paix utilisé lors de la Grande Paix de Montréal en 1701. La cérémonie, qui s’est tenue à Montréal en juin 2001, marquait le 300e anniversaire de la Grande Paix, un Traité entre les Premières Nations de la région et les colons de la Nouvelle-France.
L’essentiel de ce que nous savons de la culture, de la langue et de l’histoire des Béothuks nous vient de Shanawdithit — une jeune femme qui a passé la dernière année de sa vie auprès d’un philanthrope et scientifique qui a pris soin de préserver ses dessins et ses histoires. À la mort de Shanawdithit, en 1829, on a cru qu’elle était la dernière représentante de son peuple, mais d’autres membres de sa communauté avaient sans doute déjà intégré la population micmaque du sud de Terre-Neuve.
Les Innus, Malécites et Micmacs occupaient également le territoire du Canada atlantique au moment du premier contact avec les Européens. Les maladies d’origines européennes, comme la variole et la grippe, contribuèrent aussi à réduire leurs populations.
Les incursions des colons sur les territoires autochtones donnaient inévitablement lieu à des conflits. Dans les années 1600, la colonie du Massachusetts était en guerre contre les nations Abénakis, Narrangansett, Pequot et Wampanoag. De nombreux Amérindiens furent tués, vendus en esclavage ou intégrés aux colonies. D’autres décidèrent de fuir vers la région de la vallée du Saint-Laurent et y formèrent de nouvelles communautés, notamment les Abénakis, qui s’installèrent à Wôlinak et Odanak au Québec. Ces communautés existent toujours aujourd’hui.
La Confédération Haudenosaunee, également appelée Six Nations, a su résister aux Britanniques et aux Français. Comme les Haudenosaunee vivaient près des cours d’eau reliant New York et Montréal à l’intérieur des terres, ils pouvaient interrompre le commerce de la fourrure mené par les Européens. Ils devenaient donc la cible des agressions des Européens, mais également l’objet des tentatives de diplomatie. Par conséquent, vers la fin des années 1600, la Confédération s’est divisée en deux factions : l’une française, l’autre britannique. Certaines familles s’installèrent à Kahnawake près de Montréal et à Kanesatake près d’Oka, au Québec; ce sont encore deux communautés autochtones importantes.
D’autres Premières Nations étaient installées près des Grands Lacs. Certaines, comme les Nations Lenape, Miami et Shawnee, étaient des réfugiées et poussées vers l’Ouest hors de leurs territoires, dans la vallée de l’Ohio, par les colonies britanniques en pleine expansion. Les Anishinaabek constituaient une autre grande confédération, vivant au nord et à l’ouest des lacs Érié et Ontario. Cette confédération, composée des Nations Chippewa, Odawa, Ojibwe et Potawatomi, était devenue vers la fin des années 1600 un allié important de la Nouvelle-France. Ces événements montrent bien que les Premières Nations ont connu d’importantes transformations après 1600.
Avant 1600, les Premières Nations concluaient des Traités entre elles. Ces ententes étaient consignées sur des ceintures wampum et échangées entre nations. En acceptant la ceinture, une partie en acceptait le contenu. La ceinture témoignait alors du Traité qui avait été conclu.
À partir des années 1600, les Britanniques et les Français conclurent des Traités avec plusieurs Premières Nations afin d’encadrer leurs relations avec ces dernières, mais également pour obtenir des droits de passage et un accès aux réseaux de commerce. Au Connecticut, au Massachusetts et dans le Rhode Island, les Européens interprétèrent ces Traités comme une cession des territoires. Ils étaient retranscrits sur papier et contenaient des termes juridiques délimitant les terres qui avaient été vendues. Les Premières Nations, pour leur part, donnaient à ces ententes une autre signification.
Au 18e siècle, les ceintures wampum étaient le moyen par lequel les représentants européens communiquaient avec les Haudenosunee et d’autres nations. Par exemple, en 1766, un marchand anglais écrit qu’avant de quitter Montréal, il avait reçu des délégués de Kahnawake et Kanesatake « une ceinture et entendu un discours dans lequel ils me demandaient de faire valoir leur bonne conduite auprès du roi (George III), ce que je fis, par le truchement de Lord Shelburne, un des principaux secrétaires d’État de Sa Majesté ; à la suite de ces démarches, Lord Shelburne m’a remis la lettre ci-jointe, signifiant la satisfaction de Sa Majesté à l’égard de leur amitié et leur garantissant sa protection attentive ».
La guerre entre la Nouvelle-France et les Haudenosaunee commença dans les années 1640 et se termina avec la Grande Paix de 1701. Le Traité, signé à Montréal pendant l’été, mettait fin officiellement à six décennies de conflits dans les relations entre les Français et les Haudenosaunee. La paix fut également signée par d’autres nations occidentales, alliées des Français, incluant les nations Anishinaabek, Fox, Sauk et Winnebago. Dans le cadre du Traité, les Haudenosaunee convenaient de rester neutres dans tout conflit opposant la Grande-Bretagne et la France; ils obtenaient également un accès aux réseaux commerciaux avec les Premières Nations de l’Ouest.
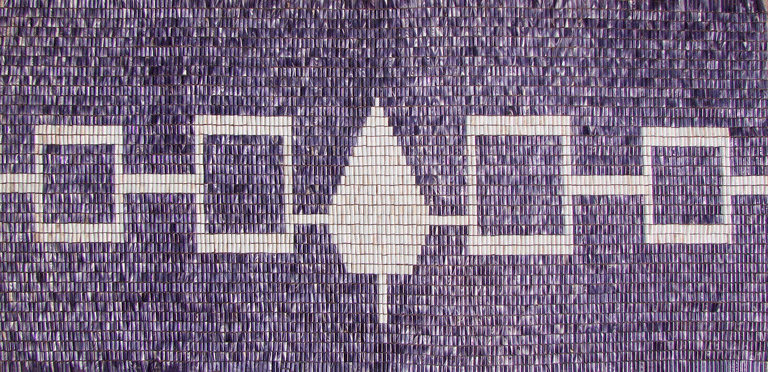
La ceinture de Hiawatha symbolise l’entente entre les cinq nations d’origine des Haudenosaunee et leur promesse de se soutenir dans l’unité. Le symbole central de l’arbre représente la Nation Onondaga où le Gardien de la paix a planté l’Arbre de la Grande Paix sous lequel les Chefs des Cinq Nations ont enterré leurs armes. Les quatre carrés blancs, de gauche à droite, représentent les tribus des Sénécas, des Cayugas, des Oneidas et des Mohawks. Les lignes qui relient les tribus illustrent la voie que d’autres nations peuvent suivre si elles acceptent de vivre en paix et de se joindre à la Confédération.
De 1701 à 1763, le conflit entre la Grande-Bretagne et la France rendit la relation avec les Premières Nations plus compliquée. Même si ces deux pays avaient déjà été en guerre, le contexte n’était plus le même au 18e siècle. La Guerre de Sept Ans (1756–1763), menée en Europe, en Asie du Sud, dans les Antilles et en Amérique centrale et du Nord, visait essentiellement à déterminer quelle nation exercerait un contrôle sur les routes commerciales mondiales des Européens. Dans les années 1750, ces activités commerciales s’étaient étendues partout sur le globe.
Dans l’Atlantique Nord, le commerce des esclaves africains et les profits générés par les plantations de canne à sucre des Antilles constituaient des enjeux attrayants pour les deux parties du conflit. Les colonies nord-américaines de la France et de la Grande-Bretagne faisaient partie de ce réseau commercial. La colonie française de l’Île-Royale (Île du Cap-Breton) produisait de la morue séchée, qui était exportée pour nourrir les esclaves afro-antillais. De son côté, la Nouvelle-Angleterre bénéficiait de la production de rhum, fabriquée à partir de mélasse, un sous-produit du processus de raffinage du sucre.
En Amérique du Nord, le coeur du conflit franco-britannique lors de la Guerre de Sept Ans était la vallée de l’Ohio. Les activités canadiennes dans la région, et une population française en pleine croissance entre l’Illinois et la Louisiane, menaçaient les intérêts britanniques. La vallée, située au sud des lacs Érié et Ontario, était devenue, vers le milieu des années 1700, une zone d’expansion pour les colonies de New York, de la Pennsylvanie et de la Virginie. Thomas Jefferson et George Washington avaient eux-mêmes des intérêts financiers dans la région.
Lors du conflit qui s’ensuivit, les représentants britanniques firent des promesses quant à leurs intentions à l’égard des territoires des Premières Nations. Ces promesses étaient nécessaires, puisque les nations Anishinaabek, Lenape, Shawnee et d’autres Premières Nations de l’Ouest étaient des alliées de la Nouvelle-France, et que leur soutien aux Français aurait affaibli les objectifs militaires des Britanniques.
Ces promesses devinrent les fondements de la Proclamation royale de 1763. Ce document visait essentiellement à restructurer les gouvernements coloniaux britanniques après l’abandon par la France de ses colonies nord-américaines dans le Traité de Paris (1763). La Proclamation établissait également les terres à l’ouest des Appalaches (de l’Ontario actuel vers l’Ouest) comme « territoire de chasse des Indiens » et interdisait à tout non-autochtone de s’y installer, sauf s’il obtenait le consentement de la Couronne. Ce consentement n’était accordé que lorsqu’une Première Nation acceptait de céder officiellement son territoire et seuls les représentants du Roi étaient autorisés à accepter une cession de territoire.
La Proclamation établissait également que les territoires déjà réservés aux Premières Nations ne pouvaient être cédés qu’avec le consentement explicite de la Première Nation l’occupant. Comme l’ont mentionné les délégués des Six Nations à Sir William Johnson, le surintendant des Affaires indiennes pour la région du nord de l’Amérique du Nord britannique, en mai 1763, « nous avons déjà vendu des terres aux Hommes blancs, mais seulement après avoir obtenu le consentement de tous lors d’une assemblée générale… » Encore une fois, le concept de « vente » n’a sans doute pas été compris de la même façon par les Européens et les Premières Nations.
Certains historiens et communautés des Premières Nations soutiennent aujourd’hui que la Proclamation établissait également tous les territoires à l’est des Appalaches en tant que territoires autochtones, sauf s’ils avaient déjà été « vendus » ou « cédés ».
Une lettre que Thomas Gage, commandant en chef des forces britanniques en Amérique du Nord, écrivit à Johnson en 1763 témoigne bien de l’importance de cette proclamation : « Je crois qu’il vous sera fort utile de disposer d’une copie de ladite proclamation, pour connaître les règlements qui ont été établis et qui sont particulièrement généreux à l’égard de toutes les tribus indiennes, mais également pour bien comprendre les articles qui les concernent; je pense que la proclamation aura une forte influence sur leur esprit et les convaincra que Sa Majesté est bien disposée à les protéger et à les favoriser. »
Les Traités de paix et d’amitié conclus par les Britanniques avec les Micmacs, les Malécites et les Passamaquoddy illustrent les problèmes de nature juridique et historique que posait l’invasion européenne des territoires des Premières Nations.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; line-height: 14.1px; font: 14.0px 'Adobe Garamond Pro'; color: #f55b46}
Les Traités introduisaient une relation juridique unique entre les Britanniques et les Premières Nations. Les Britanniques choisirent de négocier les modalités des traités avec les Micmacs et les Malécites, ce qu’ils ne firent pas avec les populations canadiennes et acadiennes. On peut ainsi dire que les Britanniques et les Premières Nations établissaient la façon dont ils allaient vivre ensemble.
Avant 1763, la France et la Grande-Bretagne combattaient pour l’Acadie, qui comprenait alors la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. Pour les Micmacs, les Malécites, les Passamaquoddy et d’autres peuples, cette région était leur terre d’origine, leur terrain de chasse et de pêche, la source de leurs remèdes, leurs sites sacrés et de sépulture, et le fondement physique et spirituel de leurs histoires, de leurs cultures et de leurs langues. Comme l’ont expliqué les Chefs micmacs au gouverneur français de l’Île-Royale en 1720 : « Sachez que nous sommes nés sur cette terre sur laquelle vous marchez et que nous l’occupions bien avant que ces arbres ne commencent à croître; cette terre nous appartient et rien ne peut nous obliger à l’abandonner. »
Vers les années 1720, les Micmacs et les Malécites commencèrent à s’inquiéter des incursions britanniques sur leurs territoires, et entre 1722 et 1725, une guerre éclata. En 1725, le Massachusetts, New Hampshire et la Nouvelle-Écosse signèrent un Traité de paix et d’amitié avec les Micmacs, les Malécites et les Passamaquoddy afin de stabiliser les relations dans la région. Dans le Traité, les Premières Nations conviennent de ne pas interférer avec les Britanniques dans « les colonies déjà installées ou dont l’installation a été autorisée par la loi, ou avec leurs activités commerciales ou autres au sein de ladite province. »
Les Britanniques, de leur côté, promettaient que les « dits Indiens ne seront pas agressés physiquement et qu’aucun tort ne sera fait à leurs territoires de chasse, de pêche et de culture, ni à aucune autre de leurs activités légales ».
Cependant, le terme « légal » n’est pas défini. Les signataires ne déterminent pas non plus où se trouvent exactement les territoires de chasse, de pêche ou de culture des Premières Nations. Il est donc difficile de savoir comment chacune des parties a compris le Traité. Cependant, un représentant des Premières Nations de la rivière Penobscot aurait dit, après qu’on l’avait informé que les Britanniques exerçaient une souveraineté absolue sur l’Acadie « selon ses anciennes frontières » délimitées dans le Traité d’Utrecht de 1713 : « Tu dis, mon frère, que la France vous a donné Plaisance, Port-Royal et les territoires environnants, et qu’elle ne conserve que le fleuve sur lequel se trouve Québec. La France peut bien vous donner ce qu’elle veut, mais moi j’ai un territoire que je n’ai donné à personne et que je n’ai pas l’intention de donner. Je veux rester le maître de ce territoire. Je connais les limites de ce territoire et si quelqu’un veut s’y installer, il devra payer. Que les Anglais prennent le bois, le poisson ou le gibier, il y en a assez là-bas pour tous, je ne leur ferai pas obstacle ».
Le Traité de 1725 n’instaura pas une paix stable. Les administrateurs français de l’ÎIe-Royale offraient des cadeaux aux Premières Nations qui attaquaient les colonies britanniques, alors que la décision des Britanniques de créer une nouvelle colonie à Halifax en juin 1749 ne fit que rendre les relations plus tendues. Même si les Micmacs réitérèrent cette paix en 1752, le conflit couvait, exacerbé par la guerre qui opposait les Français et les Britanniques. Lorsque les Britanniques firent la conquête de Québec et de Montréal en 1759-1760, les Micmacs et les Malécites firent la paix avec les Britanniques. Même si d’autres Traités furent conclus en 1778 et 1779, ils ne visaient qu’à réaffirmer cette paix après que certaines communautés avaient appuyé les forces révolutionnaires américaines.
Les Traités de paix et d’amitié conclus entre 1725 et 1779 suivirent le même exemple, les deux parties comprenant que la paix serait maintenue plus efficacement en ajoutant de nouvelles clauses et en en modifiant d’autres. Ainsi, les Traités devenaient des documents « évolutifs ».
Les Traités introduisaient une relation juridique unique entre les Britanniques et les Premières Nations. Les Britanniques choisirent de négocier les modalités des Traités avec les Micmacs et les Malécites, ce qu’ils ne firent pas avec les populations canadiennes et acadiennes. On peut ainsi dire que les Britanniques et les Premières Nations établissaient la façon dont ils allaient vivre ensemble.
Après 1763, le fondement juridique des colonies britanniques devient flou. Comme les Micmacs et Malécites n’avaient pas cédé leurs territoires dans les Traités, sur quel principe juridique les Britanniques se fondaient-ils pour accorder des terres aux colons et exploiter les ressources de la région? Ces questions et d’autres ont fait l’objet de nombreux procès. En Nouvelle-Écosse, cette situation a donné lieu à la création d’un processus de négociation des droits (Kwilmu’kw Maw Klusuaqn) qui a vu le jour en 2002 et qui continue de s’appliquer aujourd’hui pour régler les différends.
Pour les Micmacs et les Malécites, les Traités font partie d’une relation sacrée, comme un mariage, qui contient des « serments » que chaque partie a convenu de respecter aussi longtemps que les Britanniques occuperaient leur territoire de l’Atlantique. C’est pourquoi l’histoire orale des Micmacs et des Malécites garde bien vivante la mémoire de cette relation. Elle explique également pourquoi ces peuples considèrent les Traités comme le fondement de « nation à nation » sur lequel devraient continuer de reposer leurs relations futures avec les gouvernements canadiens.
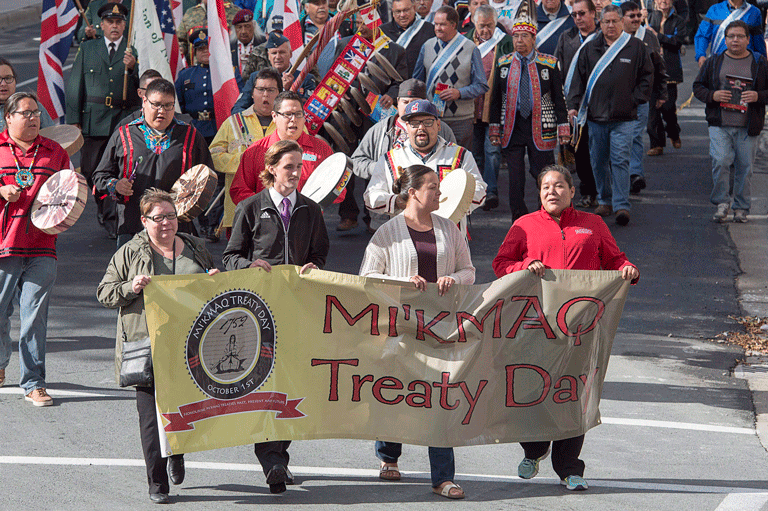
Inscrivez-vous pour recevoir la trousse pédagogique de notre numéro spécial sur les Traités et les relations qui en découlent.
Deux versions : 2e à 7e année (sec.1) & 7e à 12e année (sec.1 à cégep).
Thèmes associés à cet article
Publicité
Encore plus de contenu tiré du numéro sur les Traités
Ces articles, ainsi que les ressources pédagogiques qui les accompagnent, sont aussi offerts en anglais sur notre site Web.

Favorisons une meilleure compréhension de l’histoire et des Peuples autochtones au Canada.
Le gouvernement du Canada crée des occasions d’explorer et de faire connaître l’histoire du Canada.

La Winnipeg Foundation — à l’appui de notre périple commun vers la vérité et la réconciliation.