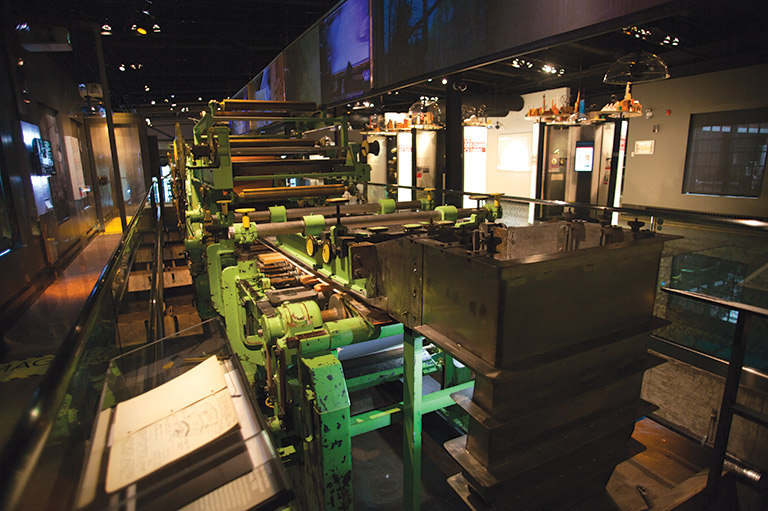Vie domestique

C’est le deuxième plus vieux métier au monde. Jusqu’à récemment, la société sans eux était presque inconcevable. Et pourtant, ils forment l’un des groupes les plus invisibles et silencieux de l’histoire canadienne : les domestiques.
La servante, le majordome, la cuisinière, le valet de pied, le cocher, le palefrenier, la nourrice, la blanchisseuse : la plupart d’entre eux étaient trop peu éduqués ou trop occupés pour passer à l’histoire. La littérature en fait rarement mention. Ils faisaient partie des meubles. En fait, les artistes s’intéressaient davantage aux meubles…
La population de la ville de Québec en 1818 atteignait environ 18 500 personnes. Un cinquième des ménages avaient des domestiques à résidence, hommes et femmes à parts à peu près égales. Quatre pour cent des ménages possédaient de nombreux domestiques, les autres un seul, généralement une femme.
Les 1 400 domestiques que comptait à peu près la ville étaient inégalement distribués, mais des mémoires de la moitié du 19e siècle évoquent leur caractère néanmoins omniprésent : lorsque les frères de Julie Joly mettent le feu aux broussailles de la côte de la Citadelle, « l’instant suivant, les servantes en bonnets et tabliers sortent en courant des maisons avec des seaux d’eau. Narcisse et Beau-Charles, ainsi que tous les hommes de service du quartier viennent également prêter main-forte ».
La ville est un joyeux mélange de cultures et d’époques, toutes représentées dans un même endroit. On y voit encore des traces de la vie en France et en Grande-Bretagne des siècles précédents, surtout au niveau des relations sociales et familiales, mais Québec est également la capitale du pays et accueille des centaines d’officiers britanniques en goguette. La ville est aussi au cœur d’une industrie en plein essor : au port, on embarque le bois pour l’exportation et on construit des navires, sans oublier les immigrants, en quête de travail. On y fait fortune ou on la cherche. Les plus vulnérables, soit les immigrants, les pauvres, les orphelins et les enfants illégitimes, se retrouvent domestiques.
Deux hommes portant le même nom, dans la même ville, la même année nous donnent un aperçu des deux univers très différents dans lesquels ils évoluèrent. En 1818, Sir James Craig, gouverneur de la colonie, dresse la liste des personnages les plus importants de la ville et organise une réception en plein air. Après le déjeuner sous les arbres, le « roi Craig » sort de sa maison « suivi de son personnel éblouissant », ainsi que d’un orchestre, ouvrant ainsi la danse. Les réjouissances sont brièvement interrompues par l’arrivée de l’évêque anglican Jacob Mountain et de l’évêque catholique Joseph-Octave Plessis, mais reprennent dès leur départ. S’ensuit un somptueux festin préparé par un cuisinier français, Monsieur Petit. Les serviteurs travaillent sans relâche pour tout préparer, mais ils seront bien récompensés, puisque le lendemain, Sir James Craig lance une fête pour ses domestiques et leurs amis.
Deux mois plus tard, un autre James Craig, veuf et « hors la loi », doit faire don à l’État de sa fille Sarah, âgée de 10 ans. À cette époque, il n’y a pas d’orphelinats ni d’hospices, et trois juges de paix décident donc d’en faire une servante chez Thomas et Mary Richards, fournisseurs. Son mandat précise qu’elle doit faire tout ce qu’on lui demande « en fonction de ses capacités, de ses connaissances et habiletés » et « et se comporter de manière honnête et obéissante ».

En retour, on lui donnera « suffisamment de viande, de boissons, de vêtements, on lui fournira le gîte et le blanchissage, ainsi que toute autre chose nécessaire à une servante ». À l’âge de 18 ans, ou à son mariage, selon la première occurrence, les Richards doivent lui remettre trois livres.
Bon nombre des domestiques de Québec étaient des enfants. Évidemment, ce constat nous choque. Mais à cette époque, les frontières entre l’enfance, la servitude et l’apprentissage sont floues.
Les liens d’affection entre les parents et leurs enfants sont tributaires des réalités de la vie quotidienne. Le fait de donner ses enfants à d’autres familles qui en font leurs domestiques était en fait la seule façon pour de nombreux enfants d’obtenir une forme d’éducation et, dans le cas de Sarah Craig, la seule façon d’assurer sa survie. Elle n’ira sans doute pas à l’école, mais apprendra à faire des chandelles et ainsi à assurer sa subsistance. Il est également fort probable qu’elle ait été considérée comme un membre de la famille.
Peu de temps avant, en Europe, les domestiques et les enfants étaient presque interchangeables. Le livre de 1549 intitulé Book of Common Prayer invite les chefs de famille à superviser l’instruction religieuse des enfants de la maisonnée – « enfants, serviteurs et apprentis » - de la même façon. En France, le mot garçon désigne un enfant ou un serviteur (on l’utilise encore pour appeler le serveur au restaurant) et le service à table n’est aucunement dégradant : il fait partie intégrante de l’éducation d’un fils de la noblesse.
Même si cette égalité semble dévaloriser le serviteur adulte, maîtres et domestiques sont liés par des liens ancestraux de responsabilité et de fidélité qui vont au-delà des contrats juridiques, comme le révèle la fête organisée par Sir James Craig. À Québec, de nombreux domestiques sont engagés sans contrat, laissant entendre que ces liens sont encore essentiellement régis par le consensus. Les contrats de certains enfants donnent une idée de ces liens : les maîtres doivent agir comme des parents responsables. Certains contrats précisent que l’enfant doit être prêt à faire sa première communion et apprendre à lire et à écrire.
Cependant, ces liens coutumiers n’excluent pas la ruse ou la brutalité. Contrat ou pas, le serviteur est presque totalement dépendant, pour le meilleur ou pour le pire, de son employeur. Une autre enfant domestique de Québec, Marie Woltz, âgée de 11 ans, est engagée par Jacques-Nicolas Perrault de Rivière-Ouelle. Elle y est clairement malheureuse et se sauve régulièrement pour retourner à Québec. Perreault intente alors un procès contre son père, un immigrant allemand travaillant comme charpentier, se plaignant que ce dernier avait « maintes fois incité sa fille à le quitter ». Le père rétorque qu’il n’y a pas de contrat écrit et que Marie se sauve parce que Perreault la maltraite.
Les serviteurs peuvent également poursuivre leurs maîtres. En 1803, Jean-Baptiste Hamel accuse George Miller, le boulanger, de refuser de lui « assurer un déjeuner et un dîner régulier, à titre de serviteur, et de lui payer ses gages ». Sarah Spratley accuse le docteur Cockburn « de l’avoir maltraitée hier et aujourd’hui… et d’avoir refusé de lui fournir ses vêtements et de lui payer [douze shillings et six pences] en gages ». Elle ne perdra pas de temps et fera entendre ses doléances le jour même.
Mais poursuivre un employeur était risqué, et le plaignant devait avoir des arguments solides (et savoir préférablement lire et écrire). De bonnes références étaient un prérequis essentiel pour décrocher un autre emploi. Survivre une semaine sans travail coûtait l’équivalent de quatre mois d’économies.

C’est donc sans étonnement qu’on recense davantage de procès intentés par des employeurs contre leurs domestiques : pour vol, ivresse, agression et désertion. Chacun évoque le drame du moment. John Mullony se souvient très bien d’avoir vu son collègue serviteur, François Chaussé, se sauver en transportant quatre dindons.
On accuse Letitia Gallagher d’avoir pris une pelisse de soie verte et un bonnet de castor. Helen Grady, de son côté, escamote un demi-poisson appartenant au capitaine Markham.
Pour adultes, les contrats sont surtout en faveur de l’employeur. Un contrat de 1816 indique qu’un serviteur doit garder pour lui les secrets de son maître, ne doit pas jouer aux cartes ou aux dés, ni fréquenter les tavernes. Ces crimes peuvent lui coûter deux mois de travail ou dix livres. Et pour bien enfoncer le clou, les lois du Bas-Canada interdisent notamment aux taverniers de servir les domestiques.
La vie des domestiques est souvent représentée dans de grandes maisons, comme les vastes domaines que l’on voit dans de nombreux films (Gosford Park) et séries télévisées (Upstairs Downstairs) britanniques.
La plupart des récits sur les domestiques du Québec sont également relatés par des familles aisées comptant de nombreux serviteurs. Les relations décrites dans ces productions évoquent leur nature coutumière et le lien de fidélité et de responsabilité qui unit maîtres et personnel; les domestiques demeuraient dans ces résidences toute leur vie et étaient pris en charge au moment de leur retraite.
Les tâches étaient partagées entre les employés de maison et parfois, des couples s’y formaient. Mais ce sont des vies dont la plupart des serviteurs ne pouvaient que rêver.
La majeure partie des domestiques étaient engagés sur une base mensuelle comme unique serviteur de l’épicier, du boucher, du meunier ou du tailleur. Leurs quartiers étaient exigus, leur vie difficile, solitaire et pleine de restrictions. Une journée de quinze à dix‑huit heures était la norme, et ils devaient tout faire par eux‑mêmes. Il y avait du bois à transporter, le feu à allumer, l’eau à tirer du puits, les pots de chambre à vider, les enfants à surveiller, les repas à préparer, les chaudrons à récurer, l’argent à polir, les vêtements à laver, à repasser et à amidonner, les chandelles à allumer et à remplacer.
Les hommes s’occupaient du travail à l’extérieur, comme pelleter la neige et le fumier, transporter le bois, s’occuper des animaux, en plus de servir à table. Avant la plomberie, l’eau devait être transportée sur plusieurs étages et la tentation était grande de tout simplement jeter les eaux usées par la fenêtre.
« Cela sera très divertissant pour vous et votre famille, lors des soirées glaciales, écrit Jonathan Swift dans sa satire Directions to Servants, de voir des centaines de gens glisser sur le dos ou sur le nez lorsque l’eau gèle ». L’autre option sera de la lancer à son maître, comme l’a fait Mary Moran avec son employeur, le tailleur James McEvoy, à Québec, en 1831.

Pourquoi lui a-t-elle jeté de l’eau sale au visage? Nous ne le saurons jamais, mais les servantes étaient vulnérables aux entreprises de séduction et au viol. Dans la Physiologie du mariage, Balzac écrit sur le caractère inéluctable de cette vulnérabilité :
Oh! Après dix ans de mariage trouver sous son toit et y voir à toute heure une jeune fille de seize à dix‑huit ans, fraîche, mise avec coquetterie, dont les trésors de beauté semblent vous défier, dont l’air candide a d’irrésistibles attraits… Comment un homme peut-il demeurer froid, comme saint Antoine, devant une sorcellerie si puissante, et avoir le courage de rester fidèle aux bons principes représentés par une femme dédaigneuse dont le visage est sévère, les manières assez revêches, et qui se refuse la plupart du temps à son amour?
L’âge moyen des servantes en 1818 était de vingt-trois ans. La plupart des jeunes femmes y voyaient un passage obligé avant de se marier, et certaines réussissaient même à faire quelques économies.
Les servantes irlandaises, cependant, arrivées en plus grands nombres dans les années 1840, étaient critiquées pour leur incapacité à épargner.
« Elles sont naturellement imprévoyantes, trop sanguines, et se soucient peu des conséquences », écrit l’auteur d’un manuel du 19e siècle sur l’art de tenir maison.
« Il est presque impossible de les convaincre de mettre une partie de leurs gages de côté. Elles dépensent leur argent dès qu’elles le touchent, soit en vêtements ou autres bagatelles, soit pour venir en aide à l’un de leurs nombreux parents restés au pays ».
L’argent envoyé en Irlande par ces servantes pour aider le reste de la famille à immigrer au Québec était une question de vie ou de mort. Leurs frères dans le port, travailleurs à bord des navires, étaient si pauvres que lorsqu’une personne mourrait à l’ouvrage (ce qui n’était pas si rare), il fallait passer le chapeau pour recueillir des fonds afin d’acheter une chandelle pour la veillée.
Rencontrer l’âme sœur alors qu’on travaille comme servante à résidence n’est pas non plus une mince affaire. Le marché était leur seul espoir. Les servantes ne pouvaient « recevoir de visiteurs dans la maison ni dans les écuries », comme le précise un contrat, et ne pouvaient quitter la maison sans permission. Les employeurs étaient prompts à punir : en 1815, le serviteur de Fred Grant, Jean Plamondon, quitta le travail à 13 h pour ne revenir qu’à 6 h le lendemain. Plus tard ce matin-là, il se retrouvait déjà devant le juge.
Les visites fréquentes au cellier étaient également une tentation et une occasion pour les domestiques de profiter des bons vins du maître. Jonathan Swift donne d’ailleurs aux majordomes de nombreux conseils à ce sujet. « Vous avez effectivement la chance de boire chaque jour la meilleure part de la bouteille de vin… mais il est possible que vos maîtres ne l’apprécient pas jusqu’à la dernière goutte. À vous, donc, de leur en servir une nouvelle après le repas ».
Les domestiques, hommes et femmes, étaient souvent traînés devant le juge de paix pour ivresse. Le majordome de la famille Joly, Beau-Charles, aimait bien prendre un petit coup, et avait un penchant pour le whisky. « Alors qu’il travaille à l’office, il chante de belles chansons tristes et les larmes se mettent à couler sur ses joues. Au début, les chansons sont douces, mais l’alcool aidant, notre homme chante de plus en plus fort. » C’est alors qu’on appelait le gendarme O’Rourke. Mais Beau-Charles ne fut jamais renvoyé.
« Lorsqu’il revient, il apporte toujours un grand gâteau avec un glaçage blanc et une inscription en lettres de sucre rose : Pardon… et encore une fois, on pardonne à Beau-Charles. »
Les cochers avaient l’excellente excuse d’abreuver les chevaux, ce qu’on faisait plus commodément à la taverne. L’Union chrétienne des femmes pour la tempérance de la province du Québec prit l’affaire en mains en installant une auge à chevaux à ses propres frais. L’abreuvoir est encore un lieu favori des cochers de Québec.
« Le Dieu suprême de l’univers a, dans sa sagesse, rendu les diverses conditions de l’humanité nécessaires au bonheur de tous : certains sont riches, d’autres sont pauvres – certains sont les maîtres, les autres les serviteurs », écrivent Samuel et Sarah Adams dans The Complete Servant en 1825. L’ivresse des uns et l’incivilité des autres témoignent du manque de respect contagieux qu’entretiennent les domestiques de Québec pour cette hiérarchie divine.
On les accusait souvent d’oublier leur place. Dès 1786, le juge en chef William Smith écrit à sa femme « Je ne connais pas la maison qui nous recommande ces domestiques, mais peu importe, il vous faut une gouvernante et une cuisinière de même caractère, ainsi qu’une femme de chambre et ses aides, et deux serviteurs… Si vous ne pouvez pas les trouver à New York, demandez à Mme Mallet de me les envoyer avec vos meubles, et de signer une entente ferme avec ceux-là, sous l’œil attentif de M. Rashleigh ou de M. Watson; les pauvres d’Europe trouvent tellement de leurs semblables ici qu’ils en oublient leur place et leurs engagements ».

La pénurie de serviteurs fait en sorte que les immigrants pauvres d’Europe, même les subalternes de la domesticité, ont la chance d’améliorer leur statut social dans ce Québec où les cultures se mélangent et où les hiérarchies ne sont pas immuables.
Cette mobilité sera le sujet de nombreuses blagues de domestiques transmises de génération en génération dans ma famille bien québécoise.
On disait notamment « C’était une bien bonne cuisinière, le temps que ça a duré! »
Les contrats qui les liaient à leurs employeurs ne semblaient pas les dissuader de partir : c’était une des rares cartes qu’ils pouvaient d’ailleurs jouer. Au 19e siècle, dans le district de Québec, l’accusation de désertion est celle qui est la plus souvent portée contre les domestiques devant le tribunal.
Une autre des bonnes blagues de mon arrière-grand-mère concernait le statut social : « Elle a des idées au-dessus de sa gare! » (en anglais, She has ideas above her station!). Cette blague en franglais reflète l’univers bilingue dans lequel évoluaient les domestiques et leurs employeurs au Québec : les familles anglophones avaient des domestiques francophones, et vice versa.
Les enfants du ménage, qui passaient souvent plus de temps avec les domestiques qu’avec leurs propres parents, grandissaient en parlant leur propre langue avec les accents et l’éloquence que confèrent des études supérieures, et leur autre langue, apprise auprès des domestiques, avec un fort accent régional et des expressions locales.
La maisonnée était peut-être bilingue, mais plus tard au cours du 19e siècle, les frontières entre les classes deviennent de plus en plus définies, comme en témoigne l’évolution architecturale des grandes demeures de Québec. Les quartiers des domestiques étaient situés près de la cuisine ou au grenier. Il y avait des entrées spéciales à l’arrière, des escaliers étroits menant aux étages à partir des cuisines au sous-sol, et des couloirs permettant de passer d’une pièce à l’autre sans déranger personne.
Le passe-plat, un petit ascenseur qui monte les repas de la cuisine, était silencieux et invisible, comme le serviteur idéal. Les domestiques devaient connaître leur rang et gare à celui ou celle qui confondait les rôles de chacun.
Lorsque ma mère annonça qu’elle appellerait sa plus jeune fille Sarah, mon arrière-grand-mère protesta en lui disant : « Tu n’y penses pas, c’est le nom de la cuisinière! »
Avec les années, le travail des domestiques devient plus ardu. La nouvelle mode des soupers tardifs oblige les domestiques à se coucher plus tard. La devise bien victorienne selon laquelle la propreté nous rapproche de Dieu prend une dimension cauchemardesque pour le personnel de maison : encore plus de seaux d’eau à monter et à descendre et plus de linge à laver. Les travaux domestiques deviennent une véritable science et les domestiques doivent suivre une formation tatillonne sur tous les aspects de leurs tâches. De moins en moins de domestiques sont apprentis : ils délaissent la confection de chandelles pour se dévouer entièrement à l’art complexe de l’entretien ménager. De nombreuses jeunes femmes préfèrent travailler dans les nouvelles usines, où elles sont plus libres et moins isolées.
Les femmes riches consacrent leur vie à des œuvres charitables, déléguant presque tout le travail de maison à leurs domestiques. Au Québec, les femmes protestantes fondent des orphelinats et des foyers pour filles immigrantes où on leur enseigne les travaux domestiques : elles peuvent ainsi superviser la formation de leurs futures servantes et choisir les meilleures. Lorsque ces dernières ont passé l’âge d’être utiles, elles sont envoyées dans des foyers protestants.
Les employeurs sont de moins en moins patients envers filles qui connaissent mal la culture et les goûts de ces grandes familles de la classe moyenne supérieure. Mais une chose ne change pas : les maîtres continuent de se plaindre de leurs domestiques. Au tournant du siècle, Charles Baillargé, un architecte de nom à Québec, écrit un mot bilieux aux Ursulines se plaignant de la formation inadéquate des jeunes orphelines dont elles ont la charge.
« Hier seulement, une nouvelle fille a non seulement gâté mon repas en coupant les deux oreilles d’un veau et en les jetant au feu (c’est la partie que je préfère), mais elle était sur le point de mettre toute la tête à bouillir au lieu de la couper en deux pour en retirer la cervelle ».
Tiré de All around the house, or, How to make homes happy, par Mme H.W. Beecher (1813-1897), publié par J. Robertson, Toronto, 1881.
Soins des tapis : les coins et les bordures des tapis ont besoin d’un examen fréquent. Voyez à remettre à la femme de chambre un balai à crin ferme, et veillez à ce qu’elle l’utilise, ainsi qu’un bâton pointu pour enlever la poussière et les mousses qui s’accumulent naturellement dans les coins et qui sont des refuges pour les mites.
Soins des matelas : les matelas doivent être pliés en leur centre comme un arc chaque matin, et les fenêtres ouvertes, même par grand froid, afin que l’air pur circule et aère le matelas. Les pots doivent être vidés et les articles éparpillés dans la chambre rangés pendant qu’on aère la pièce… Une fois par semaine…. Les matelas doivent être bien battus avec un bâton ou, encore mieux, avec un fouet à tapis formé de plusieurs tresses de rotin rassemblées par une poignée… Après avoir battu les matelas, il faut brosser soigneusement le capitonnage avec un outil pointu, comme celui employé pour nettoyer les meubles capitonnés ou touffetés.
Soins de la flanelle : La flanelle restera douce et ne foulera pas si elle est bien lavée. Il faut mettre suffisamment de savon dans de l’eau bouillante pour former une bonne mousse et ensuite y placer les articles de flanelle en les enfonçant dans l’eau avec un bâton. Lorsque l’eau a suffisamment refroidi pour qu’on puisse y plonger les mains, on frotte les articles soigneusement et une fois propres, on les essore à la main. Si vous essorez les flanelles à la machine, il se forme des nœuds et autres aspérités qui rendent la flanelle rude et désagréable au toucher. Essorez le plus possible, étendez et étirez chaque pièce au fur et à mesure, afin qu’elle conserve sa taille originale; une fois fait, jetez à nouveau dans une bassine d’eau bouillante à laquelle on aura ajouté un agent de blanchiment français bien dissous. Si la mousse du premier bain était assez vigoureuse, il restera suffisamment de savon pour l’eau de rinçage. Secouez les articles de haut en bas dans ce dernier bain avec le bâton jusqu’à ce qu’ils soient rincés et assez refroidis pour être manipulés avec les mains. Ensuite, essorez une fois rapidement, dépliez et étirez de façon à ce que l’article conserve sa forme et faites sécher par un jour de bon soleil et de vent, si possible.
On lavera une pièce à la fois. Ensuite, mettez les pièces lavées dans une deuxième bassine et placez la première au-dessus du feu pour que l’eau continue de bouillir, jusqu’à ce que vous soyez prête à laver la deuxième pièce. Gardez l’eau de rinçage chaude de la même façon pendant que vous lavez le deuxième article. Lorsque les articles de flanelle sont aux deux tiers secs, entrez-les dans la maison. Étirez à nouveau, pliez le plus également possible et roulez-les en serrant bien dans une serviette propre pendant quelque temps. Ensuite, repassez ou pressez jusqu’à ce qu’ils soient secs. Ne lavez jamais les flanelles par temps nuageux ou jour de tempête.
Thèmes associés à cet article
Publicité